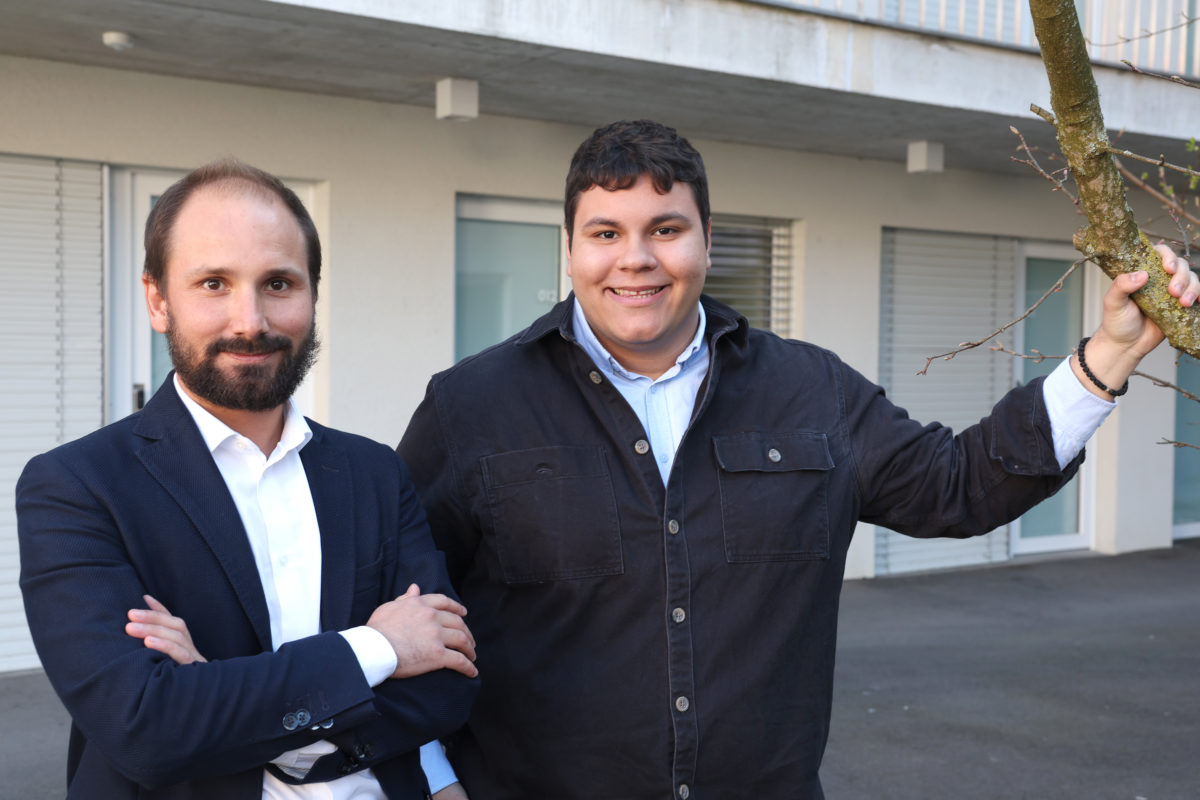Au secours du débat politique
10 avril 2025 | Textes: Jérôme Christen | Photo: Michel DuperrexEdition N°La Région Hebdo No 6
La justice vaudoise a récemment confirmé l’interdiction des débats électoraux dans les écoles, contestée par l’Yverdonnois Abdel Saiah, défendu par son camarade avocat Gaspard Genton. Ils expliquent dans un entretien les raisons qui les poussent à recourir au Tribunal fédéral.
La Cour de droit administratif et public a récemment fait siennes les considérations du Département de l’enseignement et de la formation et du conseiller d’Etat Frédéric Borloz sur la nécessité de faire respecter «le principe de neutralité de l’enseignement et d’interdiction de propagande politique». Elle invoque également le droit spécial, compte tenu du rapport entre l’école et le recourant Abdel Saiah «qui n’empêche pas d’invoquer des droits fondamentaux, mais peut les restreindre».
D’autre part, les juges estiment que la crainte de la pêche aux voix exprimée par le département est fondée et la mesure d’interdiction a un caractère proportionné: «Elle correspond à une certaine réalité, ce d’autant qu’un nombre significatif d’élèves de l’établissement scolaire sont majeurs et bénéficient du droit de vote». La Cour relève «qu’il existe d’autres lieux pour exercer ces droits et que l’école n’est pas tenue de fournir de telles prestations».
Est-il justifié d’invoquer ce droit spécial ?
Gaspard Genton: C’est décevant, car cela permet d’éviter un examen approfondi de la proportionnalité de la mesure et du but poursuivi.
Ce type de débat ne peut-il pas être organisé en dehors de l’école ?
Abdel Saiah: Oui, mais le résultat n’est pas le même. Quand des jeunes fréquentent un gymnase ou une école professionnelle, ils se retrouvent dans un espace où ils peuvent se sociabiliser. Ce contexte permet de rendre le débat accessible à toutes et tous. En dehors de l’école, on ne touche que des jeunes politisés ou des amis.
Gaspard Genton: La proximité et l’accessibilité est le fondement de la démarche. Ce qui est étonnant, c’est que le Plan d’étude romand (PER) comprend des volets «formation à la citoyenneté» et «formation à la participation politique» qui prévoient explicitement l’organisation de débats politiques dans les établissements scolaires et de formation.
N’exagérez-vous pas lorsque vous dites que ce refus viole des droits fondamentaux?
Abdel Saiah: Non, interdire un débat à l’école alors qu’il y en a eu par le passé, sans que cela pose le moindre problème, entre en contradiction avec le PER. Cette mesure est discriminatoire et injuste, ceux qui ont pris cette décision ont mené une campagne en disant qu’il fallait intéresser les jeunes à la vie politique.
Gaspard Genton: La liberté de réunion protège le droit de se réunir dans un but particulier, la liberté d’expression protège le droit de s’exprimer, mais aussi de recevoir des informations pour se forger une opinion. Dans ce cas précis, il est clairement atteint puisqu’on en prive des jeunes. Pour pouvoir restreindre les droits fondamentaux, il est nécessaire d’avoir examiné la stricte nécessité de la mesure. Les justifications données pour priver une partie de la population des droits politiques sont toujours les mêmes : les préserver de la politique. C’est d’ailleurs ce qui a justifié l’absence du vote féminin, pour préserver les femmes et la paix des familles. Pourtant, ce droit de se réunir et de se forger une opinion notamment figure dans la Constitution vaudoise. Le commentaire du projet de Constitution indique même expressément que l’un des moyens de le faire est d’organiser dans les établissements scolaires des débats et des activités participatives ! Je m’inquiète de cet a priori négatif à l’égard du débat politique qui est dangereux, car il conduirait à la pêche aux voix. Le débat devrait être considéré comme nourrissant pour la prise de décision collective.
L’école n’a-t-elle pas d’autres moyens de sensibiliser les jeunes?
Abdel Saiah: Bien sûr, mais elle ne le fait pas à part la Semaine de la citoyenneté.
Gaspard Genton: Sur la question du débat thématique versus le débat électoral, la différence est fictive car dans tous les cas, on parle de thèmes.
Les cours d’éducation à la citoyenneté ne sont-ils pas un bon moyen de sensibiliser les jeunes ?
Abdel Saiah: C’est évident, mais dans les faits, cela se fait de manière très aléatoire. Dans d’autres cantons, c’est une branche à part entière.
Gaspard Genton: Il y a plusieurs moyens d’apprendre. Cela peut prendre la forme de cours ex cathedra mais on observe qu’il est utile de le faire en étant actif.
Y a-t-il eu des précédents ?
Gaspard Genton: Sur ces questions de liberté d’expression et de réunion dans les établissements de formation, l’association Zofingue qui organise aussi des débats a gagné contre l’Université de Lausanne au Tribunal fédéral, puis contre l’EPFL
sur ces mêmes enjeux. On peut être surpris que ces questions relatives au droit à l’usage du patrimoine administratif pour l’exercice des droits fondamentaux n’aient pas été examinées à la même aune. Pourquoi les personnes en formation dans les écoles professionnelles ne bénéficieraient-elles pas de la même protection des droits fondamentaux que les Zofingiens?
L’Etat de Vaud invoque le devoir de neutralité de l’école et le risque de «pêche aux voix»
Le Département de l’enseignement et de la formation relève que la restriction porte exclusivement sur les débats de type électoral durant les dix semaines avant une ou des élections, uniquement sur le temps scolaire. Il constate que «le Tribunal cantonal a reconnu que la crainte d’une pêche aux voix suffisait pour confirmer le caractère proportionné de l’interdiction des débats dans ce cadre précis».
Cette interdiction ne conduit-elle pas à conclure que les débats politiques sont malsains?
Les débats ne sont pas interdits dans les écoles. Au contraire, tous les types de débats à visée pédagogique sont non seulement autorisés, mais souhaités et encouragés dans les écoles vaudoises, tout en veillant au respect d’une représentation équivalente des points de vue et à une modération neutre. Cela relève de la compétence des enseignantes et enseignants qui les organisent.
Le département évoque le principe d’interdiction de propagande. Pour qui?
Le terme «propagande» est utilisé dans la loi sur l’enseignement obligatoire. Les directions générales de l’enseignement obligatoire et postobligatoire ont pour mission de veiller à la neutralité de l’école et donc à limiter autant que possible le risque de propagande dans les établissements. La directive va dans ce sens, en reconnaissant la difficulté de garantir la neutralité de chaque débat électoral et face à la crainte que de tels débats n’entraînent une possible «pêche aux voix».
La pêche aux voix n’est-elle pas un effet naturel des élections dans un système démocratique?
Le DEF doit préserver la neutralité de l’école et veiller à protéger les élèves de la propagande durant le temps scolaire et dans le périmètre scolaire.
Quel est ce risque si ce n’est qu’un débatteur sera plus convaincant qu’un autre?
Il est très difficile de garantir avec certitude la neutralité de chaque débat électoral. C’est cette incertitude, et donc la crainte d’une possible «pêche aux voix», qui a mené à l’interdiction des débats électoraux avant une ou des élections. Une crainte qui constitue, selon le Tribunal cantonal, un motif suffisant pour justifier le caractère proportionné de cette décision.
N’y a-t-il pas un paradoxe à engager des moyens pour favoriser l’engagement politique des jeunes, déplorer leur manque de participation et interdire un débat qui les encouragerait à faire usage de ce droit?
Non. Il y a de nombreuses façons de stimuler l’intérêt des élèves pour la démocratie et la citoyenneté. Les débats sont toujours autorisés dans les écoles hors période électorale ou sur les objets de votation. Le département est très attaché à l’éducation à la citoyenneté qui fait d’ailleurs partie des priorités inscrites au Plan de législature 2022-2027 du Conseil d’État. De nombreuses actions et débats ont lieu dans les établissements vaudois notamment lors de la Semaine de la citoyenneté qui donne l’occasion à des élèves de s’exprimer sur des objets de votations fédérales. Dans ses observations, le Tribunal cantonal relève d’ailleurs que la possibilité d’organiser des débats thématiques sur des questions politiques précises semble mieux répondre à un objectif pédagogique et présente une plus grande valeur formatrice que les débats préélectoraux.
Les participants à dernière la session des jeunes interrogés affirment qu’ils sont insuffisamment formés à l’école à l’exercice démocratique. Que pensez-vous faire pour y remédier?
Nous regrettons ce constat qui nous motive à poursuivre nos actions en faveur de la citoyenneté en renfort de ce qui est déjà fait. Beaucoup d’initiatives sont prises dans ce sens par des établissements ou par des enseignantes et des enseignants. Ils sont encouragés à le faire et ont pour cela toute la confiance du DEF.